Quelques livres à emporter sur l'île déserte
Elena Ferrante, L'amie prodigieuse
Le nouveau nom
Celle qui fuit et celle qui reste
L'enfant perdue
Naples, 1950. Lila, dix ans, jette Tina, la poupée de Lenù au fond d'une cave. Lenù fait à son tour glisser Nù, celle de Lila, dans le cellier de Don Achille, figure simiesque de l'ogre, usurier redouté du quartier. A la quatrième volée de marches qu'elle gravissent vers la demeure de Don Achille, Lila prend la main de Lenù. Trente ans plus tard, Lila prend dans ses bras Imma, la fille de Lenù, laissant sa propre fille Tina échapper à sa surveillance. Tina disparaît alors, comme la poupée dans l'antre noir de l'usurier.
Entre ces deux événements, l'amie prodigieuse, Lila, fait et défait l'ordre du quartier au gré de son intelligence fulgurante, s'embourgeoise brutalement, s'appauvrit avec la même indifférence. Ce qu'elle aime : apprendre, exercer son génie créatif sur tout ce qui se présente et peut faire contrepoids à sa terrible lucidité.
Lenù s'éloigne pour exister, subit pourtant la force extraordinaire de cette amie exceptionnelle, et revient. Mue par le besoin d'"entendre la musique folle du cerveau de l'une faire écho à la musique folle du cerveau de l'autre"...
Le premier tome du roman, L'amie prodigieuse, narre l'enfance. Lila et Lenù grandissent à Naples, "avec l'obligation de rendre [la vie] difficile aux autres avant que les autres ne la [leur] rendent difficile". Le quartier est tout l'univers. Et Lenù découvre pour la première fois, à la faveur d'une fugue avec Lila, que l'idée d'explorer ses frontières et l'espace au-delà la stimule plus qu'elle ne l'effraie.
Le nouveau nom scelle les vies désormais parallèles des deux personnages : l'une étudiera, taraudée par un sentiment d'imposture et par l'ambiguïté des sentiments de sa mère, partagée entre la jalousie et l'espoir, corrélat du changement de classe sociale qu'elle opère ; l'autre se mariera, pour échapper à la pression de sa famille qui voit en elle le moyen de s'enrichir en unissant leur fille à un camorriste. Lila épouse Stefano pour ne pas épouser Michele, vers qui sa famille la pousse, et comprend dès le soir de son mariage que ce dernier est devenu l'employé du mafioso qu'elle méprise. La nuit de noces, nuit de viol, fragilise encore le rapport que Lila entretient à son corps. Les expériences de "délimitation", où les choses et les gens se mettent à perdre leur contour, se multiplient et toute l'énergie de Lila n'a désormais d'autre objet que de maintenir ces contours fragiles (ceux du moi qui se fragmente dans une expérience psychotique ?), et qui trouvent, dans le dernier tome, un écho tragique dans le tremblement de terre qui secoue Naples en novembre 1980.
Celle qui fuit et celle qui reste ancre le roman dans une perspective plus politique, dans les années 60-70 : Lenù, devenue romancière, fréquente désormais l'intelligentsia de gauche (et épouse le fils de l'un de ses éminents représentants, l'universitaire Airota, marié à la directrice de collection d'une des maisons d'édition les plus importantes de Florence) et Lila, devenue ouvrière après avoir quitté son mari et échappé à la camorra, s'essaie un moment à l'action militante avant d'en apercevoir, très vite, les limites. Naples devient le laboratoire des luttes sociales où s'affrontent, à la sortie des usines, les nostalgiques du fascisme dont les parents, au quartier, se sont enrichis grâce au marché noir, l'extrême gauche et les anarchistes.Comme déjà dans le premier opus, la dimension des personnages domine le troisième tome, où sont disséqués, avec une grande finesse, les mobiles, ambiguïtés et contradictions de ces engagements qui font éclater le microcosme du quartier et des amitiés d'enfance. La figure de Nino, opportuniste, polygame, à l'intelligence dévolue à une mythomanie maladive, est le versant masculin de l'intellectuel issu d'une classe populaire, mû malgré lui par l'obsession de plaire et d'échapper à son origine, dont les principes s'accommodent, peu à peu, de toutes les concessions...
Elle condense ce que le dernier tome, L'enfant perdue, laisse entendre entre les lignes : la violence du quartier, celle de Naples, celle de l'Italie des années 70, n'est que le microcosme d'une corruption qui gangrène le monde moderne : "la déception dans laquelle finissait tôt ou tard tout amour pour Naples était une loupe permettant de regarder l'Occident dans son entier. Naples était la grande métropole européenne où, de la façon la plus éclatante, la confiance accordée aux techniques, à la science, au développement économique, à la bonté de la nature et à la démocratie s'était révélée totalement privée de fondement, avec beaucoup d'avance sur le reste du monde".
Et Lila, allégorie de cet espoir né de l'intelligence, s'efface : elle disparaît comme sa fille vingt ans plus tôt, comme la poupée qui porte le nom de l'enfant perdue dans la cave de l'usurier. Lila dont l'intelligence gratuite ne se plie à aucune utilisation et à aucun but : "Lila, c'est la plèbe qui refusait d'être sauvée".
Seule, demeure la trace esthétique de cette absolue gratuité : la littérature.
Car le récit de cette amitié en scellera aussi la fin.
L'homme qui mit fin à l'histoire est une novella qui tient à la fois du récit historique, du roman d'anticipation et du documentaire. Deux scientifiques, époux à la ville, mettent au point une machine à remonter le temps : Akemi Kirino, physicienne expérimentale nippo-américaine et Evan Wei, historien sino-américain spécialisé dans le Japon classique. Constatant que, faute de pouvoir dépasser la vitesse de la lumière, utiliser un télescope dans l'espace pour voir le passé nous demeure inaccessible, ils trouvent le moyen de tricher et mettent au point une machine permettant de voyager dans le passé et de revivre des événements. Mais le passé se consumant sous nos yeux, il n'est possible d'y retourner qu'une seule fois par période visitée, sans possibilité d'agir sur ce que l'on voit.
Ken Liu revient, via cet artifice fictionnel, sur les années sombres durant lesquelles l'unité 731, commandée par le général Shiro Ishii sous mandat impérial japonais, se livre à l'expérimentation humaine qui provoquera la mort de près d'un demi-million de personnes dans la province chinoise du Mandchoukouo, entre 1936 et 1945. Il suscite, par un récit littéraire tout en finesse mêlant le documentaire, le témoignage et l'interview, une interrogation sur les liens entre fiction et histoire, sur le rapport ambigu entre l'histoire comme récit et l'histoire comme ensemble des événements passés. Il soutient l'idée troublante selon laquelle la conscience et la mémoire ont besoin de la fiction pour appréhender la réalité, qui ne parvient pas, par sa seule existence, à convaincre.
Ce faisant, il montre le rôle crucial de la littérature dans l'élaboration des connaissances humaines : l'homme a besoin de fiction pour appréhender la vérité qui, autrement, lui échappe, pour des raisons essentiellement cognitives : "oui, le cerveau reçoit les signaux et s'en sert pour créer une narration, mais le résultat n'a rien d'illusoire, ni dans le passé, ni dans le présent". Mais peut-être aussi pour des raisons psychologiques, qui dépassent en complexité les raisons politiques et l'intérêt des états : "Au long de notre histoire, nous n'avons fait fonctionner le droit international qu'en tablant sur le silence du passé" (Ken Liu rappelle qu'"à l'issue de la guerre, le général Mac Arthur, commandant en chef des forces Alliées, a préservé les membres de l'Unité 731 afin de récupérer les résultats de leurs expériences et de soustraire lesdites données à l'Union Soviétique"...).
Toute la question est là : "Quel rôle éventuel voudra-t-on attribuer à ces voix du passé dans notre présent ? A nous d'en décider". Et la force du roman de Ken Liu, c'est de ne pas seulement questionner, justement, l'intérêt des gouvernants et des états, mais aussi le désir des gouvernés sur ce délicat problème de la construction de la mémoire collective.
Comme Machiavel écrivant Le prince en italien plutôt qu'en latin, langue des seuls érudits, et analysant sans concession le besoin de fiction des gouvernés, plus attentifs à l'image du gouvernant qu'à son action politique, Ken Liu nous renvoie à notre propre ambiguïté : ainsi ce professeur de lycée australien, interviewé sur les témoignages des bourreaux de l'Unité 731, expliquant que les personnes âgées souffrant de solitude feraient n'importe quoi pour attirer l'attention, y compris avouer "ces trucs ridicules qu'ils sont censés avoir faits". Ou cet employé japonais, expliquant ces témoignages par un lavage de cerveau opéré par les communistes qui ne violentent pas les membres chinois de l'Unité 731 emprisonnés après la guerre : "J'entends encore un de ces vieillards décrire la gentillesse de ses gardes. Des gardes communistes gentils ! Si ce n'est pas la preuve d'un lavage de cerveau, ça...". Ou ce directeur chinois de magasin Sony : "La guerre est finie depuis longtemps. Il faut passer à autre chose. Ca sert à quoi de déterrer de pareils souvenirs ? Les investissements japonais en Chine bénéficient à l'emploi et tous les jeunes Chinois adorent la culture japonaise". Ou encore ce soldat japonais à la retraite, Hiroshi Abe : " Hiroshi Abe : Les soldats qui ont "avoué" ont déshonoré ce pays. Intervieweur : A cause de ce qu'ils ont fait ? Hiroshi Abe : A cause de ce qu'ils ont dit".
On ne peut plus clairement dire que les mots comptent plus que les actes. Est-ce pour cette raison que Ken Liu écrit des fictions ?
Dans ce bref roman en effet, l'auteur démontre magistralement que seule la littérature est apte à nous faire entendre la vérité.Un propos qui ne peut que résonner d'une manière puissante à une époque où la parole désinhibée de dirigeants politiques tente de nous persuader que la lecture de Mme de La Fayette n'est d'aucun intérêt pour "les guichetières" comme pour ceux qui les gouvernent. L'art, et la littérature en particulier, parce que la mémoire a besoin de récit pour s'élaborer, sont les garants de notre humanité. Ils sont, avec la philosophie, les indispensables outils critiques dont les sciences ont besoin pour réfléchir à la manière dont nous construisons nos connaissances, à l'usage que nous faisons de celles-ci et à ce que toute démarche scientifique implique, dans ses effets sur le monde et sur nous-même. De ce point de vue, les mots que Ken Liu met dans la bouche du directeur du département d'archéologie d'une grande université de Taïwan sont édifiants : "Un des paradoxes cruciaux de l'archéologie, c'est que, pour fouiller un site avant de l'étudier, il faut le détruire. Au sein de la profession, on débat à chaque site pour savoir s'il vaut mieux le fouiller ou le préserver in situ jusqu'à la mise au point de nouvelles techniques moins invasives. Mais sans fouilles destructrices, comment mettra-t-on au point ces nouvelles techniques ?".
Edifiants, car ils font écho à l'argument utilisé par les créateurs de l'Unité 731, dont l'objectif était de faire progresser les techniques chirurgicales sur les champs de bataille...
Tu, mio, Erri da Luca
La course à l'abîme, de Dominique Fernandez
David et Goliath,
Tout ce que j'aimais, de Siri Hustvedt
Extrait :
Les chaussures italiennes, Henning Mankell
Le corbac et le psychanalyste dans
L'histoire du corbac aux baskets
L'histoire du conteur électrique
Un site dédié à l'univers de Fred :
http://www.batbad.com/bateau_ivrogne.html
Chronique d'hiver, Paul Auster
Colette, Les cahiers de L'Herne
Virginia Woolf, Viviane Forrester
Entre les actes, Virginia Woolf
Entre les actes, Extrait :
Nous-mêmes ! nous-mêmes !
Ils sautent, caracolent, bondissent. Ils dansent, virent, passent comme l'éclair. Tiens, c'est le vieux Bart. Voici Manresa. Voyez ce nez... cette robe... ce pantalon... ce visage... Ils les ont attrapés... Nous-mêmes ? Mais c'est cruel, de nous attraper en instantané avant que nous ayons pu prendre... Et de ne représenter qu'un aspect... C'est une caricature ; c'est vexant ; ce n'est pas du jeu !
Tournant, s'inclinant, virant, les miroirs scintillent, reflètent, révèlent. Les spectateurs du fond se lèvent pour mieux jouir de cette drôlerie. Voici qu'eux-mêmes sont attrapés, et ils se rasseyent... Quel tableau !
La dernière leçon, Noëlle Châtelet
Les tours du silence, Bernard Châtelet
Un texte magnifique où se croisent, avec une grande maîtrise, plusieurs récits d'un jeu universel et intemporel : celui de la guerre que se livrent les hommes.
Bernard Chatelet est un joueur d'échec qui nous implique dans une partie où chaque coup peut faire ressurgir des limbes des souvenirs qui mettent en péril l'existence des protagonistes, et nous laisse troublés.
Un texte humaniste et fort.
Extrait :
Le visage du colonel, celui de Rovar, m'apparut. Je réalisai que j'étais dans une tour, la tour de l'est. L'homme portait son regard vers le nord et j'avais l'impression de voir avec ses yeux.
Je n'oublierai jamais ces minutes de temps dédoublé. J'étais dans une tour, et pourtant à aucun moment je n'ai oublié que j'étais face à Ludovic, séparé de lui par une table sur laquelle était posé un jeu d'échec.
Des bosquets s'effaçaient, d'autres apparaissaient. Un village s'esquissa dans la brume, flou d'abord, puis de plus en plus net. Des maisons flambaient, les flammes crevaient les toits. Dans les ruelles enfumées, des groupes d'humains s'échappaient en courant. Ils devaient hurler mais je n'entendais rien.
La Pleurante des rues de Prague, Sylvie Germain
Une passante, à la grâce immatérielle et claudiquante, erre dans les rues de Prague, charriant la douleur des hommes.
Un texte dont la beauté laisse sans voix.
Sylvie Germain est une orfèvre des mots, ses phrases -son phrasé, plutôt- coule à l'oreille une musique qui vient du ciel.
Extrait :
Car il semblait que quelque chose pleurât en elle, et non pas qu'elle-même versât des larmes. Peut-être bien d'ailleurs n'en versait-elle aucune. L'humide chuchotis sourdait du dedans de son corps, comme si l'inaudible rumeur du sang qui coule dans la chair se fût faite perceptible. Etait-ce là le bruit de son coeur ? Etait-ce le frémissement interne de sa chair, ou le tremblement de sa peau ? Mais sous l'effet de quelle peine ?
Alors que je la frôlais presque, ayant hâté le pas afin de la doubler et de jeter un regard sur son visage, une intuition se leva, brusque, et me fit renoncer à ma curiosité : cette femme n'avait pas de visage qui lui fût propre, elle n'était pas même une personne unique, un individu, -elle était plurielle. Son corps était un lieu de confluence d'innombrables souffles, larmes et chuchotements échappés d'autres corps.
Le joueur d'échec, Stefan Zweig
A l'occasion d'un voyage en bateau qui relie New York à Buenos-Aires, un homme renoue avec une passion qui l'a sauvé de la folie lorsque, jeune homme, il a été capturé et interrogé par la Gestapo dans un hôtel pendant plusieurs mois.
Comme toujours chez Zweig, la vision d'un monde en décomposition se profile derrière l'étude psychologique subtile des personnages.
Extrait :
Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à mon cadre habituel, que j'étais un captif innocent, tourmenté depuis des mois par la solitude, un homme en qui la colère s'était accululée sans qu'il pût la décharger sur rien ni sur personne. Aucune diversion ne s'offrant, excepté ce jeu absurde contre moi-même, ma rage et mon désir de vengeance s'y déversèrent furieusement. Il y avait un homme en moi qui voulait son droit, mais il ne pouvait s'en prendre qu'à cet autre moi contre qui je jouais ; aussi ces parties d'échecs me causaient-elles une excitation presque maniaque. Au début, j'étais encore capable de jouer calmement, je faisais une pause entre les parties pour me détendre un peu. Mais bientôt mes nerfs irrités ne me laissèrent plus de répit. A peine avais-je joué avec les blancs que les noirs se dressaient devant moi, frémissants. A peine une partie était-elle finie qu'une moitié de moi-même recommençait à défier l'autre, car je portais toujours en moi un vaincu qui réclamait sa revanche.
La fin de Chéri, Colette
L'histoire d'un homme-objet, construit par le désir d'une femme, qui prend conscience qu'être un objet aux yeux de l'autre vous prive vous-même de désir, et qui en meurt.
Colette décrit avec une grâce inégalable l'errance d'un très jeune homme perdu dans le regret d'un gynécée.
Extrait :
Une femme écrivait, le dos tourné, assise devant un bonheur-du-jour. Chéri distingua un large dos, le bourrelet grenu de la nuque au-dessous de gros cheveux gris vigoureux, taillés comme ceux de sa mère. "Allons, bon, elle n'est pas seule. qu'est-ce que c'est que cette bonne femme-là ?"
- Mets-moi aussi par écrit l'adresse, Léa, et le nom du masseur. Moi, tu sais, les noms... dit une voix inconnue.
Une femme en noir, assise, venait de parler, et Chéri sentit en lui-même un remous précurseur. "Alors... où est Léa ?"
La dame au poil gris se retourna, et Chéri reçut en plein visage le choc de ses yeux bleus.
- Eh ! mon dieu, petit, c'est toi ?
Il avança comme en songe, baisa une main.
- La princesse Cheniaguine, Monsieur Frédéric Peloux.
Chéri baisa une autre main, s'assit.
- C'est ?... questionna la dame en noir, en le désignant avec autant de liberté que s'il eût été sourd.
Le grand rire innocent résonna de nouveau, et Chéri chercha la source de ce rire, là, ici, ailleurs, partout ailleurs que dans la gorge de la femme au poil gris...
- Mais non, ce n'est pas ! Ou ce n'est plus, pour mieux dire ! Valérie, voyons, qu'est-ce que tu vas chercher ?
Elle n'était pas monstrueuse, mais vaste, et chargée d'un plantureux développement de toutes les parties de son corps. Ses bras, comme de rondes cuisses, s'écartaient de ses hanches, soulevés près de l'aisselle par leur épaisseur charnue. La jupe unie, la longue veste impersonnelle entr'ouverte sur du linge à jabot, annonçaient l'abdication, la rétractation normales de la féminité, et une sorte de dignité sans sexe.
Je, François Villon, Jean Teulé
Jean Teulé narre dans une langue crue et superbe la folie, la démesure d'un temps et d'un homme, génie de la poésie. Son récit, alliant subtilement éléments biographiques et poèmes, trouble par son extrême violence et sa stupéfiante beauté. Jean Teulé restitue l'homme dans le pire et le meilleur, pris dans une époque où les charcutiers, à la nuit tombée, venaient, au péril de leur vie, récupérer la chair gratuite des condamnés fraîchement suppliciés à Montfaucon.
Ames sensibles s'abstenir...
Extrait :
Le lendemain, je suis si perdu que les gens que je croise ne me voient peut-être pas. Je n'ai plus le goût du jeu et du rire. De corps et de visage, je me trouve si bouleversé que j'ai l'air d'un fou. Je me tords les poings de douleur pour avoir tué et pris le bien d'habitants peut-être, aujourd'hui, ensevelis morts et froids. Las de cette écorcherie et plus noir que mûre, je vais seul à travers les labours. poils brûlés à ma barbe et pelisse en peau de cerf portée sur le dos, je n'attaque plus que la chair des fruits cueillis aux haies, aux arbres. Mon destin - la désespérance d'un poète en haillons qui laissera à toutes les broussailles d'ici à Roussillon les lambeaux de son méchant vêtement. Je vais chercher ailleurs meilleure fortune.

/image%2F0675867%2F20180207%2Fob_fa91a0_l-amie-prodigieuse.jpg)
/image%2F0675867%2F20180207%2Fob_e4aa15_le-nouveau-nom.jpg)
/image%2F0675867%2F20180207%2Fob_25f889_celle-qui-fuit-et-celle-qui-reste.gif)
/image%2F0675867%2F20180207%2Fob_f5fb3e_l-enfant.jpg)

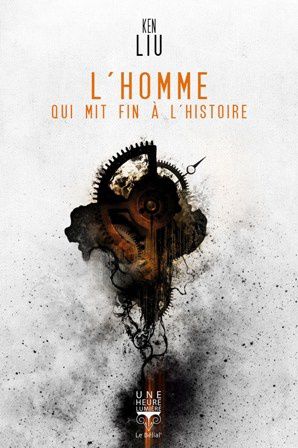






















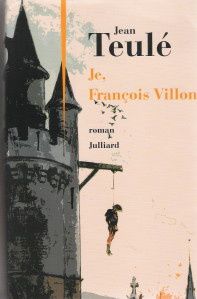


/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FJDhWimHvJKo%2Fhqdefault.jpg)
/image%2F0675867%2F20170107%2Fob_f4dd63_ob-93b0fa-article-presse-conference-se.jpg)
/image%2F0675867%2Fob_8316b0_couv-narcoses-garance.jpg)
/image%2F0675867%2F20150716%2Fob_ca21bf_bandeau-ng-960x300-crop.jpg)
/fdata%2F3015913%2Favatar-blog-1103029347-tmpphpCbxsRZ.jpeg)